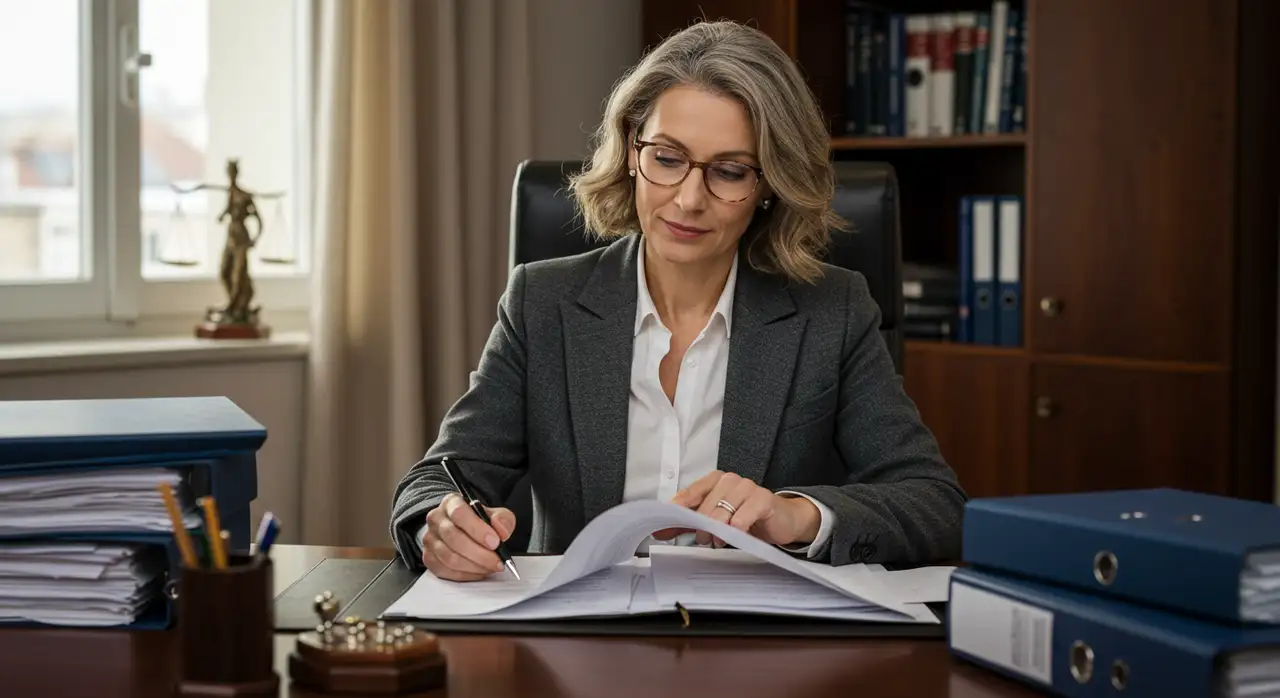Le redressement judiciaire est une procédure collective, encadrée par la loi, qui s’offre aux entreprises en difficulté, celles qui sont en état de cessation des paiements. Mais attention, il ne s’agit pas d’une solution miracle.
L’objectif principal est double : d’abord, permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise. Ensuite, assurer autant que possible le maintien de l’emploi, tout en organisant l’apurement du passif, c’est-à-dire le remboursement des dettes.
C’est une alternative à la liquidation judiciaire, cette dernière signifiant l’arrêt pur et simple de l’activité. Il est important de le distinguer également de la procédure de sauvegarde, qui intervient plus en amont, lorsque l’entreprise rencontre des difficultés mais n’est pas encore en cessation de paiement.
Ce guide vous aidera à démystifier le redressement judiciaire, à comprendre ses enjeux et à prendre les meilleures décisions pour l’avenir de votre entreprise.
Définition et objectifs du redressement judiciaire
Le redressement judiciaire est donc une procédure collective qui s’adresse aux entreprises en cessation de paiement, c’est-à-dire lorsqu’elles ne peuvent plus faire face à leurs dettes avec leur actif disponible. L’objectif premier, c’est de donner une chance à l’entreprise de se remettre sur les rails. Comment ? En élaborant un plan de redressement viable.
Cette mesure vise à réorganiser l’entreprise, à négocier avec les créanciers et à mettre en place des mesures pour assurer sa pérennité. Il permet de suspendre temporairement le paiement des dettes, le temps de mettre en place ce plan.
Redressement judiciaire, sauvegarde et liquidation : quelles différences ?
Il faut bien distinguer ces trois procédures. La procédure de sauvegarde est une mesure préventive, destinée aux entreprises qui rencontrent des difficultés, mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements. Elle vise à éviter le dépôt de bilan.
À l’opposé, la liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Elle entraîne la vente des actifs de l’entreprise pour rembourser les dettes, et généralement, la fin de l’activité.
Le redressement judiciaire se situe entre ces deux options, offrant une dernière chance à l’entreprise de se redresser avant d’envisager une liquidation judiciaire.
À qui s’adresse le redressement judiciaire ?
La procédure de redressement judiciaire concerne un large éventail d’entreprises.
Entreprises concernées par la procédure de redressement judiciaire
Le redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, mais aussi à celles exerçant une activité libérale, ainsi qu’aux agriculteurs et aux associations.
En clair, toute entité économique qui rencontre des difficultés financières et se trouve en état de cessation des paiements peut demander l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Conditions pour bénéficier du redressement judiciaire
Pour ouvrir une procédure de redressement, plusieurs conditions doivent être remplies. La plus importante est bien sûr l’état de cessation de paiement.
L’entreprise doit également justifier de la possibilité de permettre la poursuite de l’activité. Si le redressement est manifestement impossible, le tribunal judiciaire prononcera directement une liquidation judiciaire. La demande d’ouverture d’un redressement judiciaire doit être déposée au tribunal judiciaire au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation de paiement.
En général, c’est le débiteur lui-même, c’est-à-dire le chef d’entreprise, qui prend l’initiative de demander l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Cependant, les créanciers peuvent également le faire, bien que cela soit plus rare. Enfin, le tribunal judiciaire peut se saisir d’office de la situation. Il est important de souligner que la demande d’ouverture d’un redressement doit intervenir au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation de paiement. Au-delà de ce délai, l’entreprise s’expose à des sanctions.
La phase préliminaire : diagnostic et alternatives au redressement judiciaire
Avant d’envisager une procédure de redressement judiciaire, il est crucial d’explorer toutes les options possibles. Un diagnostic précoce des difficultés financières peut ouvrir la voie à des solutions moins radicales. Imaginez que votre entreprise est comme un patient : mieux vaut prévenir que guérir. Avant de passer à une opération lourde, on essaie d’abord les traitements moins invasifs. C’est exactement la même chose ici.
Alors, quelles sont ces alternatives ? Comment identifier les premiers signes de cessation de paiement ? Et comment mettre en place des stratégies pour éviter d’en arriver à un redressement ? Nous allons explorer ensemble ces questions essentielles.
L’importance d’un diagnostic précoce des difficultés financières
La réactivité est la clé. Plus tôt vous identifiez les problèmes, plus vous avez de chances de les résoudre sans avoir recours à une procédure collective. Un diagnostic financier régulier, c’est comme un check-up médical pour votre entreprise.
Les procédures amiables : conciliation et mandat ad hoc
Il existe des solutions à l’amiable pour éviter le redressement judiciaire. La procédure de conciliation et le mandat ad hoc sont deux options à envisager. Elles permettent de négocier avec les créanciers et de trouver des solutions sur mesure. C’est une approche plus douce, moins contraignante qu’une ouverture d’une procédure devant le tribunal judiciaire.
La procédure de sauvegarde : une alternative préventive au redressement
La procédure de sauvegarde est une autre option intéressante. Elle permet à l’entreprise de se protéger de ses créanciers avant même d’être en état de cessation des paiements. C’est une sorte de bouclier préventif, qui permet de geler le passif et de mettre en place un plan pour assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise.
Avantages et inconvénients de la procédure de conciliation avant d’envisager un redressement judiciaire
La procédure de conciliation offre de nombreux avantages, mais elle a aussi ses limites. Elle est confidentielle, rapide et peu coûteuse. Elle permet de préserver l’image de l’entreprise et de maintenir de bonnes relations avec les créanciers. Cependant, elle nécessite l’accord de toutes les parties et n’est pas toujours adaptée aux situations les plus complexes. Elle peut être une solution idéale si le redressement n’est pas manifestement impossible et peut permettre le redressement de l’entreprise.
Le déroulement de la procédure de redressement judiciaire : étape par étape
Ça y est, toutes les alternatives ont été explorées et le redressement judiciaire s’avère inévitable. Mais concrètement, comment se déroule cette procédure ? Quelles sont les étapes clés ? De la requête initiale jusqu’à l’adoption (ou non) d’un plan de redressement, en passant par la période d’observation, chaque phase a son importance. C’est un peu comme une enquête : il faut rassembler les preuves, analyser la situation et proposer une solution adaptée.
La requête d’ouverture d’un redressement judiciaire : contenu et dépôt au tribunal judiciaire
La procédure de redressement judiciaire démarre officiellement avec le dépôt d’une requête auprès du tribunal judiciaire compétent (généralement le tribunal de commerce). Cette requête, c’est un peu comme une lettre de détresse adressée à la justice.
Elle doit contenir un certain nombre d’informations cruciales :
- Un état détaillé de l’actif disponible et du passif, permettant d’évaluer l’ampleur des difficultés financières. Il faut être transparent et exhaustif.
- Une description précise des causes de la cessation de paiement. Pourquoi l’entreprise en est-elle arrivée là ? Quels sont les facteurs qui ont conduit à cet état de cessation des paiements ?
- Les perspectives de poursuite de l’activité de l’entreprise. Croyez-vous encore en un avenir ? Quelles sont vos pistes pour rebondir ?
- Les propositions de plan de redressement. Comment comptez-vous sortir de cette situation ? Quelles mesures envisagez-vous pour assainir les finances de l’entreprise et apurer le passif ?
La requête doit être déposée au tribunal judiciaire au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation de paiement. Ce délai est impératif. Le non-respect de cette échéance peut avoir des conséquences fâcheuses.
Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire
Si le tribunal judiciaire estime que les conditions sont réunies, il prononce un jugement d’ouverture du redressement judiciaire. C’est un acte officiel qui marque le début de la procédure.
Ce jugement a des conséquences importantes :
- Il suspend les poursuites individuelles des créanciers. Plus de panique, vous avez un peu de répit ! Les créanciers ne peuvent plus vous harceler pour récupérer leur dette.
- Il désigne un administrateur judiciaire, chargé d’assister ou de représenter le dirigeant de l’entreprise, et un mandataire judiciaire, chargé de représenter les intérêts des créanciers. Ces deux professionnels seront vos alliés tout au long de la procédure. Le mandataire judiciaire et de l’administrateur sont donc essentiels.
- Il fixe la période d’observation, une phase cruciale pour évaluer la situation de l’entreprise et déterminer si un redressement est possible.
La période d’observation : diagnostic et analyse de la situation de l’entreprise
Le redressement judiciaire débute donc par une période d’observation. Cette phase est une sorte d’autopsie financière de l’entreprise. Elle permet de comprendre les raisons de ses difficultés et d’évaluer ses chances de survie.
Durant cette période d’observation, l’administrateur judiciaire procède à un examen approfondi de la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Il analyse les comptes, les contrats, les perspectives de marché, les relations avec les créanciers, etc.
L’objectif est double :
- Établir un diagnostic précis des causes de la cessation de paiement.
- Déterminer si l’entreprise a un avenir et si un plan de redressement peut être mis en place.
Cette période d’observation a une durée maximale fixée par la loi. Elle peut être renouvelée, mais ne peut excéder une certaine limite. Le temps est compté, il faut agir vite et bien. L’ouverture du redressement judiciaire ouvre une période cruciale !
La déclaration de créances par les créanciers
Pendant la période d’observation, les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire. C’est une étape obligatoire pour pouvoir être payés, au moins en partie, si un plan de redressement est adopté.
Chaque créancier doit fournir un justificatif de sa dette (facture, contrat, etc.) et indiquer le montant exact qu’il réclame. Le mandataire judiciaire vérifie ensuite ces déclarations et établit une liste des créances admises.
C’est une étape délicate, car elle peut générer des tensions entre l’entreprise et ses créanciers. Il est donc important d’être transparent et de communiquer clairement avec toutes les parties prenantes.
L’élaboration du plan de redressement ou la conversion en liquidation judiciaire
À l’issue de la période d’observation, deux scénarios sont possibles :
- Si l’administrateur judiciaire estime que l’entreprise a un avenir, il élabore un plan de redressement. Ce plan propose des mesures concrètes pour assainir les finances de l’entreprise, rembourser les dettes et assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise.
- Si l’administrateur judiciaire considère que le redressement est manifestement impossible, il propose au tribunal judiciaire de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. C’est la fin de l’espoir, l’entreprise est condamnée à disparaître.
Le plan de redressement doit être approuvé par le tribunal judiciaire. S’il est validé, il est mis en œuvre et l’entreprise tente de se relever. Sinon, c’est la liquidation judiciaire.
Ce plan de redressement judiciaire doit définir précisément les modalités de règlement du passif. Il permet de fixer un échéancier pour les paiements, et d’organiser un apurement du passif.
Les acteurs clés de la procédure de redressement judiciaire
Le redressement judiciaire est une pièce de théâtre complexe, où plusieurs acteurs jouent un rôle essentiel. Des professionnels du droit, des représentants des créanciers et des magistrats interviennent.
Qui sont ces acteurs et quel est leur rôle exact ? Comment interagissent-ils pour mener à bien cette procédure collective ?
Le débiteur (l’entrepreneur) : droits et obligations
L’entrepreneur, en tant que débiteur, se retrouve au cœur de la procédure de redressement judiciaire. Il conserve certains droits, mais doit également assumer des obligations. Il a le droit d’être informé et consulté à chaque étape de la procédure. Son consentement est requis pour certaines décisions importantes, comme la vente d’actifs. Il a également le droit de contester les décisions du tribunal judiciaire.
Mais il a aussi des obligations : il doit coopérer avec l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, fournir toutes les informations nécessaires, et respecter les décisions du tribunal judiciaire. C’est un équilibre délicat à trouver, mais essentiel pour le bon déroulement de cette procédure.
L’administrateur judiciaire : missions et responsabilités
L’administrateur judiciaire est un peu comme le médecin de l’entreprise. Son rôle est de diagnostiquer les maux dont elle souffre et de proposer un traitement adapté. Nommé par le tribunal judiciaire dès l’ouverture de la procédure, il a pour mission d’assister ou de représenter le dirigeant de l’entreprise, selon les pouvoirs qui lui sont confiés par le tribunal judiciaire. Il analyse la situation financière de l’entreprise, élabore un plan de redressement, et veille à la sauvegarde des intérêts de l’entreprise et de ses salariés.
C’est un expert impartial, dont l’objectif est de permettre le redressement de l’entreprise. L’assistance de l’administrateur judiciaire est primordiale.
Le mandataire judiciaire : rôle et missions
Le mandataire judiciaire, lui, est le représentant des créanciers. Son rôle est de défendre leurs intérêts et de s’assurer qu’ils soient payés, au moins en partie, dans le cadre du plan de redressement. Il vérifie les créances déclarées, établit la liste des créances admises, et participe aux négociations avec le débiteur et l’administrateur judiciaire.
C’est un interlocuteur essentiel pour les créanciers, qui peuvent ainsi faire valoir leurs droits. Ses honoraires du mandataire judiciaire sont fixés par un barème légal.
Les créanciers : droits et participation à la procédure
Les créanciers, qu’ils soient des banques, des fournisseurs ou des salariés, sont directement concernés par la procédure de redressement judiciaire. Ils ont le droit d’être informés du déroulement de la procédure et de participer aux décisions importantes. Ils doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans les délais impartis, sous peine de ne pas pouvoir être payés.
Ils peuvent également voter sur le plan de redressement proposé par l’administrateur judiciaire. Leur participation active est essentielle pour trouver une solution équitable et durable. Il est important de noter que le redressement judiciaire concerne aussi ces acteurs.
Le tribunal judiciaire : pouvoir de décision et contrôle de la procédure
Le tribunal judiciaire, et plus précisément le tribunal de commerce dans la majorité des cas, est le chef d’orchestre de la procédure de redressement judiciaire. C’est lui qui prend les décisions importantes, comme l’ouverture d’une procédure de redressement, la désignation des administrateurs et mandataires judiciaires, l’approbation du plan de redressement, ou la conversion en liquidation judiciaire.
Il veille au respect de la loi et à la protection des intérêts de toutes les parties prenantes. C’est un garant de l’équité et de la transparence de la procédure. L’importance de être déposée au tribunal judiciaire est donc capitale.
Les conséquences du redressement judiciaire pour l’entreprise
L’ouverture de la procédure entraîne un certain nombre de conséquences importantes pour l’entreprise, tant sur le plan financier que juridique. Comment cette procédure collective affecte-t-elle la gestion quotidienne, les relations avec les partenaires et l’image de l’entreprise ? Quelles sont les mesures mises en place pour protéger les intérêts de toutes les parties prenantes ?
Suspension des poursuites individuelles des créanciers
L’un des effets immédiats et les plus importants du jugement d’ouverture du redressement judiciaire est la suspension des poursuites individuelles des créanciers. Imaginez un instant : votre entreprise croule sous les dettes, et chaque jour apporte son lot de relances, de mises en demeure et de menaces de saisies. L’ouverture d’un redressement stoppe net ce harcèlement.
Concrètement, cela signifie que les créanciers ne peuvent plus engager de nouvelles actions en justice pour obtenir le paiement de leurs créances. Les procédures en cours sont également suspendues. C’est une bouffée d’air frais pour l’entreprise, qui peut enfin se concentrer sur son redressement.
Mais attention, cette suspension n’est pas éternelle. Les créanciers doivent déclarer leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans un certain délai. Une fois ce délai dépassé, ils ne pourront plus faire valoir leurs droits. Cette mesure vise à organiser le passif de l’entreprise et à garantir un traitement équitable de tous les créanciers. Elle est essentielle pour l’élaboration d’un plan de redressement.
Incidence sur les contrats en cours
Le redressement judiciaire a également des conséquences sur les contrats en cours de l’entreprise. En principe, ces contrats continuent de s’appliquer, sauf si l’administrateur judiciaire décide de les résilier.
Pourquoi résilier un contrat ? Eh bien, imaginez un contrat qui pèse trop lourd sur les finances de l’entreprise, ou qui n’est plus adapté à sa situation actuelle. L’administrateur judiciaire peut demander au tribunal judiciaire l’autorisation de le résilier. Cette décision est prise dans l’intérêt de la poursuite de l’activité de l’entreprise et de son redressement.
Inversement, l’administrateur judiciaire peut exiger l’exécution de contrats qui sont essentiels à la survie de l’entreprise. Par exemple, un contrat de fourniture de matières premières ou un contrat de location de locaux. Cela permet de maintenir l’actif disponible et de garantir la continuité de l’exploitation pendant la période d’observation.
Gestion de l’entreprise pendant la période d’observation et après l’adoption du plan de redressement
L’ouverture du redressement judiciaire ouvre une période d’observation. Pendant cette période, le dirigeant de l’entreprise conserve ses pouvoirs de gestion, mais il est assisté ou représenté par l’administrateur judiciaire.
Selon les cas, l’administrateur judiciaire peut :
- Assister le dirigeant dans ses décisions : il donne son avis et veille à ce que les décisions prises soient conformes à l’intérêt de l’entreprise et de ses créanciers.
- Représenter le dirigeant : il prend les décisions à sa place, avec l’accord du tribunal judiciaire.
L’objectif est de permettre à l’entreprise de se restructurer et de retrouver une situation financière saine. L’administrateur judiciaire élabore un plan de redressement, qui est ensuite soumis au vote des créanciers. Si le plan de redressement judiciaire est adopté, l’entreprise doit le mettre en œuvre, sous le contrôle de l’administrateur judiciaire ou du mandataire judiciaire.
La gestion de l’entreprise est donc encadrée, mais l’objectif reste de permettre le redressement de l’entreprise et de sauvegarder les emplois.
Impact sur l’image de l’entreprise et les relations avec les partenaires
Reconnaissons-le, la mise en redressement judiciaire peut avoir un impact négatif sur l’image de l’entreprise. Certains clients peuvent s’inquiéter de sa pérennité, et certains fournisseurs peuvent hésiter à continuer à travailler avec elle.
Il est donc essentiel de communiquer de manière transparente avec ses partenaires et de leur expliquer les mesures mises en place pour assurer le redressement de l’entreprise. Il faut rassurer ses clients, négocier avec ses fournisseurs, et informer ses salariés.
Une communication efficace peut permettre de limiter les effets négatifs sur l’image de l’entreprise et de préserver les relations avec ses partenaires. Car, au bout du compte, c’est la confiance qui permettra à l’entreprise de rebondir et de retrouver une situation financière saine. Le maintien de l’emploi est également un facteur clé.
Le plan de redressement : la clé de la pérennité de l’entreprise
Après avoir traversé les étapes préliminaires et la période d’observation, le moment crucial arrive : l’élaboration du plan de redressement. C’est un peu comme si l’on dressait une carte pour sortir du labyrinthe. Ce document stratégique, élaboré avec l’aide de l’administrateur judiciaire, va définir comment l’entreprise va se restructurer, apurer son passif et assurer sa pérennité. Comment ce plan est-il conçu ? Quelles sont les différentes options pour rembourser les dettes ? Et comment s’assurer que le plan est respecté sur le long terme ? Découvrons ensemble les rouages de cette étape cruciale.
Contenu et objectifs du plan de redressement
Le plan de redressement, c’est l’ordonnance du médecin pour guérir l’entreprise malade. Il doit être précis, réaliste et adapté à la situation de l’entreprise. Son objectif principal est de permettre le redressement de l’entreprise et la poursuite de l’activité de l’entreprise, tout en assurant le paiement des créanciers.
Concrètement, le plan de redressement judiciaire doit contenir :
- Un diagnostic précis de la situation financière et économique de l’entreprise.
- Les mesures envisagées pour restructurer l’entreprise. Cela peut inclure des suppressions de postes, des cessions d’actifs, des renégociations de contrats, etc.
- Les modalités d’apurement du passif. C’est-à-dire comment l’entreprise va rembourser ses dettes.
- Les prévisions financières pour les années à venir.
- Les engagements du dirigeant et des actionnaires.
Le plan est ensuite soumis au vote des créanciers. S’ils l’acceptent, il est validé par le tribunal judiciaire et devient obligatoire pour toutes les parties. Le plan de redressement est donc un document essentiel pour l’avenir de l’entreprise.
Les différentes modalités d’apurement du passif : délais de paiement, remises de dettes
L’apurement du passif est un élément central du plan de redressement. Il s’agit de définir comment l’entreprise va rembourser ses dettes. Plusieurs options sont possibles, et elles peuvent être combinées :
- Délais de paiement : L’entreprise peut demander à bénéficier de délais de paiement plus longs que ceux initialement prévus.
- Remises de dettes : Les créanciers peuvent accepter de renoncer à une partie de leurs créances. C’est un geste fort, mais qui peut être nécessaire pour assurer la survie de l’entreprise.
- Conversion des dettes en capital : Les créanciers peuvent accepter de transformer leurs créances en parts sociales de l’entreprise. Cela leur permet de devenir actionnaires et de participer à la relance de l’entreprise.
- Cession d’actifs : L’entreprise peut vendre certains de ses actifs pour rembourser ses dettes.
Le choix des modalités d’apurement du passif dépend de la situation financière de l’entreprise et des négociations avec les créanciers. Il est essentiel de trouver un équilibre entre les intérêts de l’entreprise et ceux de ses créanciers.
Le suivi de l’exécution du plan de redressement
Une fois le plan de redressement validé, il ne suffit pas de se croiser les doigts et d’espérer que tout se passe bien. Il faut suivre attentivement son exécution.
-
L’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire, selon les cas, est chargé de contrôler le respect du plan par l’entreprise. Il vérifie que les mesures prévues sont mises en œuvre, que les dettes sont remboursées conformément aux échéances, et que les prévisions financières sont respectées.
-
Si l’entreprise ne respecte pas ses engagements, le tribunal judiciaire peut décider de modifier le plan de redressement, voire de prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Le suivi de l’exécution du plan de redressement est donc essentiel pour s’assurer que l’entreprise est sur la bonne voie et qu’elle pourra retrouver une situation financière saine.
Sortie du redressement judiciaire : la fin de la procédure
Le plan de redressement est adopté, l’entreprise se restructure, les dettes sont en cours de remboursement. C’est une période intense, où chaque étape est scrutée, chaque décision analysée. Mais quel est le dénouement de cette procédure de redressement judiciaire ? Comment se termine-t-elle ?
La fin du redressement judiciaire signifie que l’entreprise a réussi à surmonter ses difficultés et qu’elle est en voie de retrouver une situation financière saine. Mais attention, la route peut encore être longue et semée d’embûches.
Exécution complète du plan de redressement
Le scénario idéal, bien sûr, c’est l’exécution complète du plan de redressement. Imaginez : toutes les échéances respectées, toutes les dettes remboursées, l’entreprise qui retrouve une rentabilité durable.
C’est le signe que le redressement de l’entreprise est un succès. L’entreprise a prouvé sa capacité à se restructurer, à honorer ses engagements et à se projeter dans l’avenir.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire constate l’exécution du plan et met fin à la procédure de redressement judiciaire. L’entreprise retrouve alors sa pleine autonomie et peut poursuivre son développement sans les contraintes liées à la procédure collective. C’est un nouveau départ, une page qui se tourne.
Clôture de la procédure de redressement judiciaire
Mais il existe d’autres cas de figure. La procédure de redressement judiciaire peut également être clôturée pour d’autres raisons :
- Extinction du passif : Si, pendant la période d’observation ou pendant l’exécution du plan, l’entreprise parvient à désintéresser tous les créanciers, le tribunal judiciaire peut prononcer la clôture de la procédure. C’est un peu comme éteindre tous les voyants rouges d’un tableau de bord.
- Absence de passif exigible : Si l’entreprise ne dispose plus d’actif disponible suffisant pour payer les dettes, le tribunal judiciaire peut également prononcer la clôture de la procédure. Attention, cela ne signifie pas que les dettes sont effacées, mais simplement que la procédure n’a plus de raison d’être.
- Conversion en liquidation judiciaire : Malheureusement, il arrive que le redressement soit impossible. Si l’entreprise ne parvient pas à respecter le plan de redressement, si sa situation financière se dégrade, ou si l’état de cessation des paiements persiste, le tribunal judiciaire peut décider de convertir la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. C’est un échec, mais parfois la seule solution pour protéger les intérêts des créanciers. Dans ce cas, une liquidation judiciaire est prononcée.
La clôture de la procédure de redressement judiciaire marque donc la fin d’une étape, mais elle ne signifie pas nécessairement la fin de l’histoire de l’entreprise.